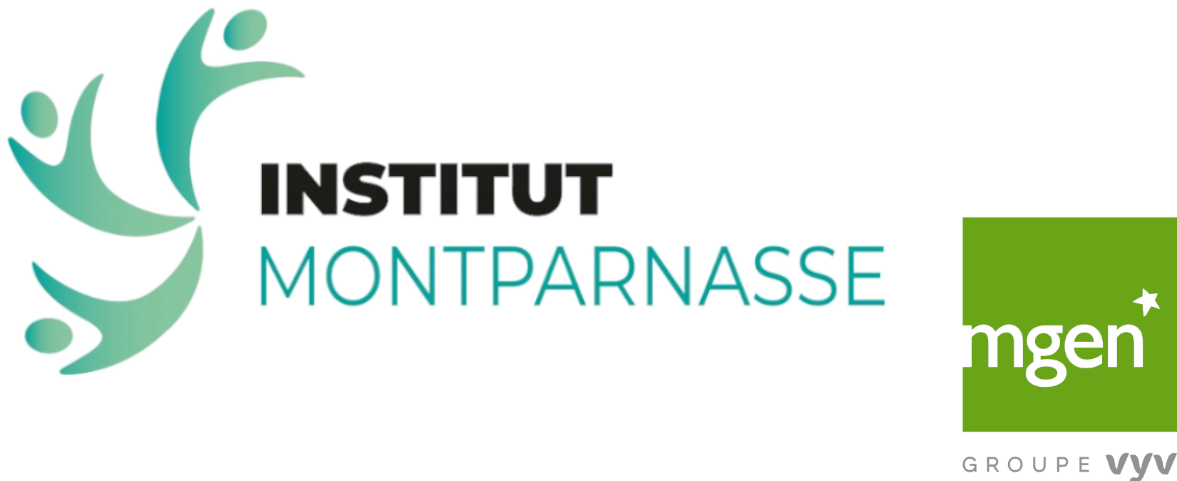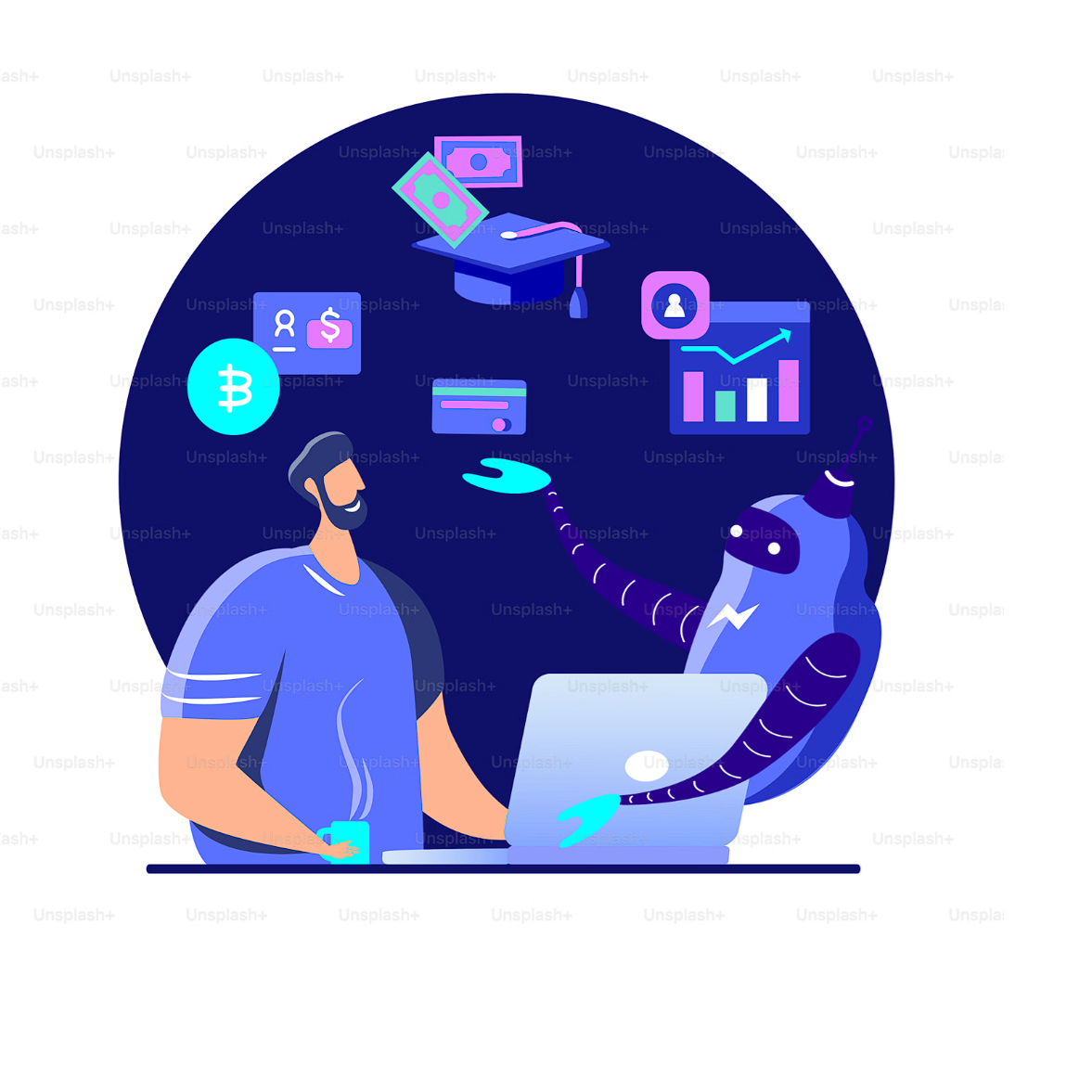Cet article est le second d'une série de 3 articles, dont vous pouvez retrouver le contenu dans le PDF ci-dessus.
VERS UNE INTELLIGENCE ARTIFICIELLE A LA HAUTEUR DU MUTUALISME ?
Des travaux épistémologiques à intégrer
Il est indispensable d’évoquer la méthode de conceptualisation relativisée (MCR) conçue par la Pr. Mioara Mugur-Schächter, physicienne et épistémologue.
Son œuvre porte notamment sur les constructions de nos connaissances, Sur le tissage des connaissances. [1] Mioara Mugur-Schächter, Sur le tissage des connaissances, Lavoisier, 2006.
Elle montre combien nos esprits fonctionnent avec des intentions. Nos postulats épistémologiques sont à questionner, aussi lucidement que possible. Cette méthode permet de sortir d’une propension aux intolérances, au raisonnement binaire, donc à la conclusion ravageuse que ce dont nous sommes accablés procède soit de la fatalité soit de la malignité d’un bouc émissaire. Dans un monde fait d’interdépendances multiples à haute vitesse, il n’est pas évident que nos modes de gouvernance puissent encore longtemps se nourrir d’un tel réductionnisme.
Nous retiendrons donc cette citation, d’une haute valeur éthique : « Toutes nos actions découlent de notre pensée et celle-ci est frappée au sceau des structures logiques et probabilistes qui agissent dans nos esprits.
Si elles y agissent sans être connues, leur action, comme les souvenirs refoulés hors du conscient, reste brute, non dominée, stupide parfois, au sens d’inadéquation aux buts. » [2] Mioara Mugur-Schächter, Les leçons de la mécanique quantique : vers une épistémologie formalisée, Le
Débat, n° 94, mars-avril 1997, p. 22.
Avec Alvin (1928-2016) et Heidi (1929-2019) Toffler, nous insistons aussi sur le phénomène contemporain massif de désynchronisation entre le temps, l’espace et la connaissance. Avons-nous encore le temps de vivre, de prendre à bras-le-corps des expériences directes de vie et de faire les efforts de comprendre ?
Il y a actuellement sur la planète huit milliards de cerveaux, bien plus qu’à aucun moment de l’histoire humaine, et nous avons construit, au cours de ces dernières décennies, un immense mégacerveau extérieur complémentaire, réparti dans les ordinateurs et les liens entre eux. Ils peuvent conclure : « Nous vivons, en réalité, le bouleversement le plus profond du système mondial du savoir depuis que notre espèce a commencé à penser. Tant que nous n’aurons pas digéré ce fait, tous nos projets les plus élaborés pour l’avenir tourneront court. » [3] Alvin et Heidi Toffler, La richesse révolutionnaire, Plon, 2007, p. 162.
Selon Statista, le volume de données numériques créées ou répliquées par an dans le monde, en zettaoctets, 1 Zo valant mille milliards de milliards d’octets soit 10 21 octets, l’octet étant une unité d’information de huit bits, soit un ensemble de huit chiffres binaires pouvant prendre les valeurs de 1 ou 0, était estimé à hauteur de 2 en 2010 et de 64 en 2020. Il devrait se situer à environ 181 en 2025.
Un danger est évident : davantage de données, moins de réflexion, d’audace conceptuelle et finalement de compréhension et de sens construits par des échanges souvent informels, c’est-à-dire humains, entre nous.
Sciences humaines, sociales et politiques…
Sans pouvoir détailler, il est certain que les efforts mutualistes et éthiques, à leur meilleur, luttent contre les incantations magiques, le manichéisme, la manipulation démagogique de l’information, la marginalisation des opinions divergentes, les préjugés, etc.
Ces procédés sont destinés à priver les phénomènes de leur intelligibilité propre. Ils ont produit et produisent encore bien des désastres sur la planète.
Les dirigeants n’avancent guère plus que le caractère pur de leurs intentions quitte à nier continûment la réalité de ce que les citoyens vivent effectivement.
Certaines positions et postures semblent encourager le cynisme qui projette sur les autres que leurs éventuels comportements altruistes seraient forcément égoïstes, bonne base pour s’affranchir de la décence ordinaire et conclure qu’il
faut diriger, espionner, manager, réguler, censurer et commander les autres.
Sans scrupules, la fin justifiant les moyens.
On cherchera vainement les recherches scientifiques sur la théorie de Nicolas Machiavel (1469-1527) dans Le Prince : « On peut, en effet, dire généralement des hommes qu’ils sont ingrats, inconstants, dissimulés, tremblants devant les dangers et avides de gain. »
Depuis longtemps, l’historien et sociologue Marcel Gauchet, en particulier,
documente tous ces travers. [4] Marcel Gauchet avec Eric Conan et François Azouvi, Comprendre le malheur français, Stock, 2016.
Au total, une véritable guerre contre les métiers de service des autres, ceux des enseignants, des professionnels de santé, de la petite enfance et du handicap, des agriculteurs, artisans et commerçants de proximité, des chercheurs, des entrepreneurs employeurs, de celles et ceux qui construisent et font fonctionner les réseaux vitaux, semble avoir été entreprise, de longue date.
Si l’IA doit en être l’ultime étape, elle sera rejetée. Comme il en est de l’écologie politique punitive injuste. Le mérite aux discours ou le mérite aux actions quotidiennes ?
Entre l’abattement de qui se perçoit dépassé – et beaucoup est fait au titre de la confection top-down des consentements et de la fabrique de l’impuissance – et les exaltations d’une IA bisounours, on recommandera plutôt le travail d’Eric Horvitz et de son épouse, depuis 2009, de suivi des progrès de l’IA et de ses impacts sociaux, sur cent ans. On se reportera à AI100, One Hundred Year Study on Artificial Intelligence. [5] https://ai100.stanford.edu/
II. De quelques dangers qui peuvent inspirer le débat mutualiste…
On retiendra principalement les fausses informations, spécialité multimillénaire de certains pour asseoir leur domination.
Malheureusement, les fausses vidéos et l’usurpation d’identité, les sites frauduleux et malveillants, les cybermenaces, la divulgation de secrets des personnes et des organisations, le piratage de systèmes logistiques et de voitures autonomes contrôlés par l’IA, le chantage et la propagande à grande échelle et les divers instruments de guerre hybride, sont à l’ordre du jour.
Prises de contrôle de robots ou d’armes à des fins criminelles, escroquerie et manipulation de marchés financiers, corruption de données, détournement des systèmes de reconnaissance faciale, aussi.
En ajoutant l’effacement de preuves, la dissimulation d’informations criminelles, la multiplication de faux avis et encore la traque et la contrefaçon, l’IA de confiance pourrait s’avérer prioritaire, notamment à l’égard des plus jeunes. Il est remarquable que le sommet et la semaine pour l’action sur l’intelligence artificielle, à Paris, en février 2025, aient porté notamment sur l’intérêt public et l’IA de confiance, soit une IA explicable, certifiable, équitable, responsable. [6] Laure de Roucy-Rochegonde, Promesses artificielles ou régulation réelle ? Inventer la gouvernance mondiale
de l’IA, Institut français des relations internationales, 2025.
Au chapitre des emplois, assez clairement, bien des emplois de la banque et des assurances, de la comptabilité, du secrétariat, de la grande distribution et de la manutention sont susceptibles de bouleversements.
Les ressources de la formation et de la reconversion professionnelle seront massivement sollicitées. Chacune et chacun ne peuvent devenir Data engineer ou Machine learning engineer.
Avant de spéculer sur les emplois laminés, on peut mettre en évidence ceux que l’IA incite à requalifier, sous des conditions intelligentes de formation et de personnalisation.
Un minimum de dialogue social permettrait d’éviter que les dirigeants, entrepreneurs, salariés et fonctionnaires ne fournissent intentionnellement ou par mégarde des données confidentielles ou sensibles aux différentes versions de ChatGPT, par exemple. D’ailleurs, l’AI Act européen différencie les utilisations, selon la gravité potentielle des biais, erreurs, mésusages. Qu’il s’agisse de marketing ou de santé.
Il demeure que les pouvoirs, se reposant souvent sur l’idée d’une supériorité intellectuelle, adorent littéralement infantiliser. Lorsque cela ne suffit pas, on ajoutera, à haute dose, des messages anxiogènes et une masse de chiffres.
Au profit d’une gouvernance mécaniste sous volonté de saturation du temps de cerveau disponible de la plupart d’entre nous.
Avoir largement refusé, depuis le début de l’Ere numérique, de débattre des méthodes, calculs et logiques comptables, a « ruiné les âmes ». Vive le pilotage automatique des affaires humaines ! Vive la gouvernance par les textes et les nombres !
Il ne s’agit pas d’une domination de l’espèce humaine par des machines ayant développé des intentions malveillantes.
Mais bien de vrais dangers inhérents aux biais cognitifs et à la détestation des libertés des autres de la part de quidams qui, généralement, sont à l’abri du sort commun, eux-mêmes et leur descendance.
Sur ce dernier point, si les grands patrons de la Silicon Valley – 11 500 entreprises de haute technologie – ont été incontestablement des créateurs et ont su construire des équipes de premier ordre, il en est certains que leurs
intérêts ont poussé jusqu’au transhumanisme. Alors même qu’il y a tant à faire pour le bien commun de l’humanité telle qu’elle est.
On peut s’interroger sur ce qui peut conduire des esprits parfois géniaux et toujours exceptionnels à s’estimer mandatés pour dessiner l’avenir de l’espèce humaine sur la dialectique de notre obsolescence et de notre rédemption par l’IA. Une IA mieux partagée et de bien commun ne serait-elle pas référable ?
Qu’en sera-t-il de la texture de l’expérience vécue, sensible, charnelle ?
Peut-on encore s’interroger sur le considérable geste métaphysique consistant à prendre les machines, les semi-conducteurs et les capteurs pour modèles de l’humanité ?
Peut-on encore s’interroger sur la réduction de l’être humain à un statut informationnel à traiter, sans être rangé aux magasins des accessoires d’un conservatisme obtus ?
Peut-on encore s’interroger sur les conflits possibles entre le poids des données et les éclairs de la création et de l’espoir humains ?
Peut-on encore tenter d’incarner une vision de notre esprit non pas comme un agrégat de contenus mais comme un ensemble d’activités : surprise et étonnement, critique et créativité, imagination et méditation ?
Fonder nos avenirs sur la modélisation prédictive, à partir des données présentes et passées, peut affaiblir à la fois les engagements démocratiques et les capacités humaines de prise en compte des incertitudes et des complexités.
Jusqu’aux diverses accusations propagandistes, via un langage chargé pour produire des réponses émotionnelles.
Entre la guerre des intelligences et l’existence par les seules polémiques sur les réseaux, nous y perdrons bien plus que notre latin.
Au détriment du relions-nous, en nous efforçant de dépasser l’appétit national pour les classements qui deviennent des clivages sociologiques.
GPS, objets connectés, achats en ligne, e-banking, réseaux sociaux, sites de rencontres, visioconférences, sites dédiés pour les impôts, l’administration, les plaintes en justice, applications de santé, montre connectée, quantified self sont dans nos vies.
Intimement liés à l’acquisition des appareils, aux abonnements, codes et mots de passe, à la création de comptes et profils, aux cases préformatées, clics, suivis de process élaborés par d’autres. Servitude diffuse ?
III. Vers une Déclaration universelle des droits de l’esprit humain…
Face à cet immense appareil de conformisation à un ordre établi, d’alignement sur l’état de choses existant, le philosophe Mark Hunyadi met en garde.
Il évoque un autoconservatisme dépourvu de toute transcendance, au pur service de sa propre hégémonie et comment le régime temporel de la rapidité-immédiateté-disponibilité s’impose, d’instant en instant.
Désormais, dépendance au numérique et principe de commodité nous habituent à satisfaire sans délai le moindre de nos besoins, caprices, désirs, volontés. L’effort et la joie de la quête ne sont-ils pas liquidés ?
Plus encore que d’autres livres cités ici, sa proposition de Déclaration universelle des droits de l’esprit humain vaut d’être partagée et mise en œuvre. [7] Mark Hunyadi, Déclaration universelle des droits de l’esprit humain. Une proposition, Presses universitaires de
France/Humensis, 2024.
Nous le citons : « Aucun dispositif à fort impact mental et sociétal ne devrait pouvoir être mis sur le marché sans concertation, procédure et évaluation préalables, voire autorisation de l’autorité dédiée, comme il est au demeurant
toujours d’usage dans les autres domaines de l’activité humaine, lorsque de grands risques veulent être évités. » [8] Ibid., p. 95.
Le modèle existe : l’Autorité internationale des fonds marins, fondée sur la période 1982-1994, sous l’égide de l’Organisation des Nations Unies.
Avec l’esprit, si rien n’est apparemment détruit, il s’agirait plutôt de nous protéger d’intrusions nuisibles, d’appropriations exclusives, de formatages hégémoniques et, au total, d’un affaiblissement général de la liberté et de la coopération humaines, donc de nos motivations et qualités mutualistes.
Citons le début de sa proposition de 8 articles : « Nous, les peuples de la Terre, rappelant la richesse inestimable de l’esprit humain, source fondamentale de création artistique et intellectuelle, de diversité culturelle, de visions du monde et d’identité, proclamons solennellement cette Déclaration, dans l’intention d’œuvrer solidairement à la préservation et à la promotion de l’intégrité de l’esprit humain, patrimoine commun de l’humanité.
Article 1
L’esprit humain est intrinsèquement libre, inaliénable et universel, constituant le fondement de l’identité humaine et de la diversité culturelle. (…)
Article 2
(…) L’intimité mentale requiert également un accès équitable au repos de l’esprit et à son droit de ne pas être sollicité. » [9] Ibid., pp. 109-110.
IV. Ethique et éthique des pratiques…
Si l’éthique comporte une dimension profondément intime à chacune et chacun, ces pages sont aussi l’occasion d’exprimer de la gratitude à nos maîtres qui tous traversaient les frontières entre disciplines. [10] Nous saluons tout particulièrement la mémoire du Dr. Jean-Louis Coy (1940-2023). Naturellement, la MGEN, particulièrement ses établissements de soins, sont fortement présents.
Eléments de définition
Si la morale indique une voie à suivre, l’éthique est une question, un doute non péremptoire, un premier mot d’un travail toujours en cours.
Et Edgar Morin, à la fin de son Ethique, le dernier livre de La méthode, écrit :
« Le sens que je donne, finalement, à l’éthique, s’il faut un terme qui puisse englober tous ses aspects, c’est la résistance à la cruauté du monde et à la barbarie humaine. » [11] Edgar Morin, La méthode 6, Ethique, Seuil, 2004, p. 227.
Ses dernières lignes sont : « Aimez le fragile et le périssable, car le plus précieux, le meilleur, y compris la conscience, y compris la beauté, y compris l’âme, sont fragiles et périssables. » [12] Ibid., p. 232.
Comme l’éthique, dont la simple évocation pourrait même distiller rejets et violences si elle est instrumentalisée au détriment des libertés, labellisée, réduite au respect de formalismes imposés d’en-haut par des donneurs de leçons. Se l’approprier, ne serait-ce pas l’anéantir ?
Tentons d’approfondir.
Principes moraux. On ne vole pas. On ne tue pas. Il s’agit de conditions de possibilité de l’humanité. En outre, tous les mammifères sociaux ont des codes qui limitent vol et meurtre.
Valeurs incarnées : elles renvoient à nos engagements.
Manières d’être éthique : comportements qui consistent à intérioriser le principe. Il y a éthique lorsque le principe est vécu.
La tenue, la droiture et le style incarnent notre volonté. On peut penser à la
musique : la tenue du violon et de l’archet, l’accordage d’un piano, d’un orgue,
de tout un orchestre.
L’éthique et l’esthétique semblent liées. Et le poète Pierre Reverdy (1889-1960)
d’écrire : « L’éthique est l’esthétique du dedans. »
Pour Héraclite, « L’éthique est la manière dont l’homme HABITE le monde. » [13] François Grémy, De quelques dimensions éthiques et philosophiques de la décision en santé publique… et ailleurs, Santé publique 2008, volume 20, n° 4, pp. 327-339.
Il y a vingt-cinq siècles, que voulait-il exprimer par là ? La façon dont l’homme conçoit et pratique ses relations avec lui-même, avec les autres, avec la Terre-patrie et, éventuellement, Dieu ou les dieux.
Par Ethique, Paul Ricoeur (1913-2005) entend la visée d’une vie accomplie sous le signe des actions estimées bonnes, c’est-à-dire « Le souhait d’une vie accomplie – avec et pour les autres – dans des institutions justes. » [14] Paul Ricoeur, Lectures 2. La contrée des philosophes, Seuil, 1992, p. 204.
La morale est l’articulation de cette visée dans des interdits et devoirs variables selon la civilisation, la culture, les circonstances et le contexte.
La question « Que dois-je faire ? » relève de la morale.
Quel héritage éthique chacun d’entre nous a-t-il reçu ?
Pour certains, l’accès à de grandes œuvres, sans doute. Rendons hommage ici à titre personnel à trois de ces œuvres : l’archipel du Goulag d’Alexandre Soljenitsyne, Guerre et Paix de Léon Tolstoï, Le Monde d’hier, de Stefan Zweig.
Pour toutes et tous, François Cheng nous écrit : « La vie est faite de rencontres. A mesure qu’on avance en âge, on se rend compte que son destin est fait en réalité de quelques rencontres décisives. » Et de souligner : « Au cœur de l’humanité ont surgi des figures admirables qui répandent sur nous lumières et consolations. Elles font la grandeur de l’homme et nous tirent sans cesse vers le haut. » [15] François Cheng, Cinq méditations sur la mort autrement dit sur la vie, Albin Michel, 2013, p. 122.
Formes de l’éthique
On peut imaginer que les formes de l’éthique s’apparentent à celles d’un iceberg. Chaque jour, des milliards de paroles, de gestes et de décisions éthiques discrètes sont créés. Autant de preuves d’éthique et même d’auto-éthique. Tout particulièrement dans l’enseignement, la santé, les services à la personne, la maintenance des réseaux vitaux.
Chaque jour, nombre d’entre nous prennent sur eux pour que l’économie humaine vive, de l’alimentation à la salubrité publique et aux secours d’urgence. L’économie humaine a pour but direct l’amélioration des conditions de vie des personnes. Des millions d’entreprises sociales, dirigées pour moitié par des femmes, réunissent plus de 300 millions d’emplois, dans le monde.
Pouvons-nous exprimer un doute quant à leur prise en compte par l’IA, si elle était souhaitable et souhaitée ?
Avec la visibilité, grands courants et spécialités de l’éthique rencontrent la puissance et de possibles conflits entre juristes, philosophes, éthiciens. Qui dira quelle est l’éthique des éthiciens ? Qui niera qu’une langue de bois éthique puisse se développer, à grand renfort de commentaires, déclarations, chartes et alignements de l’IA sur des codes éthiques solennels, liquidateurs des contextes vivants ?
Des heurts entre convictions et responsabilités peuvent générer des souffrances supplémentaires.
Si les fondamentaux des temporalités, espaces, savoirs et les liens entre données, informations, connaissances, expériences, compréhensions, sens sont déstabilisés à chaque instant, proposer des boussoles est vital.
Tel est notre propos orienté sur la nécessité et les conditions de débats aussi éthiques que possible, boussoles pour les transformations vitales.
Pour Karl Popper : « (…) Le plus important des dix commandements dit : Tu ne tueras point ! Il résume presque toute l’éthique ». [16] Karl Popper, La Leçon de ce siècle, Anatolia Editions, 1993, pp. 137-138.
Et il y a bien des façons de tuer les autres : management toxique, chômage de longue durée, gaspillage, misère, injustices, pollutions, corruptions, criminalité multinationale organisée…
Aux moteurs les plus évoqués de l’Histoire, la lucidité ferait ajouter sottise et bêtise.
Choix désastreux et passions aveuglantes, dont celles de l’argent sans maître et du pouvoir, sont ainsi propulsés, à toutes les échelles. Au total, les coûts de pauvre qualité et les déséconomies externes détruisent de 20 à 40% des ressources. Ressources dont il faut toujours interroger l’origine laborieuse.
S’agissant des développements de l’éthique, pensées et actions, sur les nouveaux espaces de l’Ere numérique [17]Modestement, nous essayons de penser l’IA comme l’une des composantes majeures de l’Ere numérique. Ainsi, le débat infoéthique précède largement les applications spectaculaires récentes … Continue reading , des propositions ont été faites.
Gérard Théry (1933-2021), ingénieur général des télécommunications, dans le rapport au Premier ministre de 1994, Les autoroutes de l’information, propose le néologisme « info-éthique ». Au chapitre du multimédia, il souligne : « La définition d’une “info-éthique” devra faire l’objet d’une réflexion particulièrement attentive associant l’ensemble du corps social. » [18] Rapport officiel au Premier ministre, Les autoroutes de l’information, p. 10.
De 1997 à 2000, l’UNESCO consacre à l’INFOethics plusieurs conférences. Philippe Quéau, ingénieur et philosophe, s’y engage. [19] Son blog Metaxu porte le sous-titre : Pour une anthropologie de la conscience.
Au titre de son programme information pour tous, l’UNESCO, en 2022, précise que : « L’éthique de l’information englobe les aspects éthiques, juridiques et sociétaux des applications des TIC [20] Technologies de l’information et de la communication. et s’inspire de la Déclaration universelle des droits de l’homme. »
Les travaux de l’UNESCO sur l’éthique et la gouvernance de l’IA découlent de la Recommandation sur l’éthique de l’intelligence artificielle, qui a été adoptée par 193 pays en 2021. [21] https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381137_fre
De 2019 à 2021, la Commission nationale française pour l’UNESCO et la MGEN, sous l’autorité d’Eric Chenut, ont procédé ensemble à de nombreuses consultations qui ont donné lieu à la synthèse Ethique de l’intelligence artificielle, des données et du transhumanisme. [22]Le président du conseil scientifique de l’Institut Montparnasse est reconnaissant d’avoir pu y participer.Nombre des meilleurs experts français de ces domaines ont accepté de s’y … Continue reading
La Recommandation a donné mandat à l’UNESCO de produire des outils pour aider les États membres. Ainsi, la « Méthode d’évaluation de l’état de préparation » permet aux gouvernements de dresser un tableau complet de leur degré de préparation à la mise en œuvre de l’IA de manière éthique et responsable pour tous les citoyens. [23] https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000385198_fre
Le questionnement est remarquable sur des axes majeurs : ordre général, juridique, social/culturel, scientifique/éducatif, économique, technique et infrastructurel.
Cependant, une question nous taraude : comment éviter que de tels travaux ne débouchent sur des constats de solennelle inefficacité ou, pire, sur quelques slogans médiatiques accrocheurs ou polémiques ou encore sur l’oubli décourageant pour celles et ceux qui y auront consacré le meilleur de leur engagement, de leur expérience, de leurs connaissances ? Ainsi, pensons-nous particulièrement aux œuvres sur l’IA des Académies et de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques.
La construction d’une éthique mondiale constituant un immense défi, il est certainement encore presque impossible aux délégués de 194 Etats membres et de 12 membres associés d’aborder les problématiques éthiques de manière
frontale. En effet, les principes éthiques de base qui tous s’appliquent à l’IA sont loin d’être vécus partout : respect, protection et promotion des droits de la femme, de l’homme et de l’enfant, des libertés fondamentales et de la dignité humaine ; droit au respect de la vie privée et protection des données ; équité et non discrimination ; principes de proportionnalité et d’innocuité ; transparence et explicabilité ; surveillance, décision et responsabilité humaines.
PAGE 21 - l'éthique des pratiques...
References[+]
| ↑1 | Mioara Mugur-Schächter, Sur le tissage des connaissances, Lavoisier, 2006. |
|---|---|
| ↑2 | Mioara Mugur-Schächter, Les leçons de la mécanique quantique : vers une épistémologie formalisée, Le Débat, n° 94, mars-avril 1997, p. 22. |
| ↑3 | Alvin et Heidi Toffler, La richesse révolutionnaire, Plon, 2007, p. 162. |
| ↑4 | Marcel Gauchet avec Eric Conan et François Azouvi, Comprendre le malheur français, Stock, 2016. |
| ↑5 | https://ai100.stanford.edu/ |
| ↑6 | Laure de Roucy-Rochegonde, Promesses artificielles ou régulation réelle ? Inventer la gouvernance mondiale de l’IA, Institut français des relations internationales, 2025. |
| ↑7 | Mark Hunyadi, Déclaration universelle des droits de l’esprit humain. Une proposition, Presses universitaires de France/Humensis, 2024. |
| ↑8 | Ibid., p. 95. |
| ↑9 | Ibid., pp. 109-110. |
| ↑10 | Nous saluons tout particulièrement la mémoire du Dr. Jean-Louis Coy (1940-2023). |
| ↑11 | Edgar Morin, La méthode 6, Ethique, Seuil, 2004, p. 227. |
| ↑12 | Ibid., p. 232. |
| ↑13 | François Grémy, De quelques dimensions éthiques et philosophiques de la décision en santé publique… et ailleurs, Santé publique 2008, volume 20, n° 4, pp. 327-339. |
| ↑14 | Paul Ricoeur, Lectures 2. La contrée des philosophes, Seuil, 1992, p. 204. |
| ↑15 | François Cheng, Cinq méditations sur la mort autrement dit sur la vie, Albin Michel, 2013, p. 122. |
| ↑16 | Karl Popper, La Leçon de ce siècle, Anatolia Editions, 1993, pp. 137-138. |
| ↑17 | Modestement, nous essayons de penser l’IA comme l’une des composantes majeures de l’Ere numérique. Ainsi, le débat infoéthique précède largement les applications spectaculaires récentes de l’IA. |
| ↑18 | Rapport officiel au Premier ministre, Les autoroutes de l’information, p. 10. |
| ↑19 | Son blog Metaxu porte le sous-titre : Pour une anthropologie de la conscience. |
| ↑20 | Technologies de l’information et de la communication. |
| ↑21 | https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381137_fre |
| ↑22 | Le président du conseil scientifique de l’Institut Montparnasse est reconnaissant d’avoir pu y participer. Nombre des meilleurs experts français de ces domaines ont accepté de s’y exprimer. https://unesco.delegfrance.org/Publication-du-rapport-CNFU-MGEN-sur-l-Ethique-de-l-Intelligence-Artificielle |
| ↑23 | https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000385198_fre |