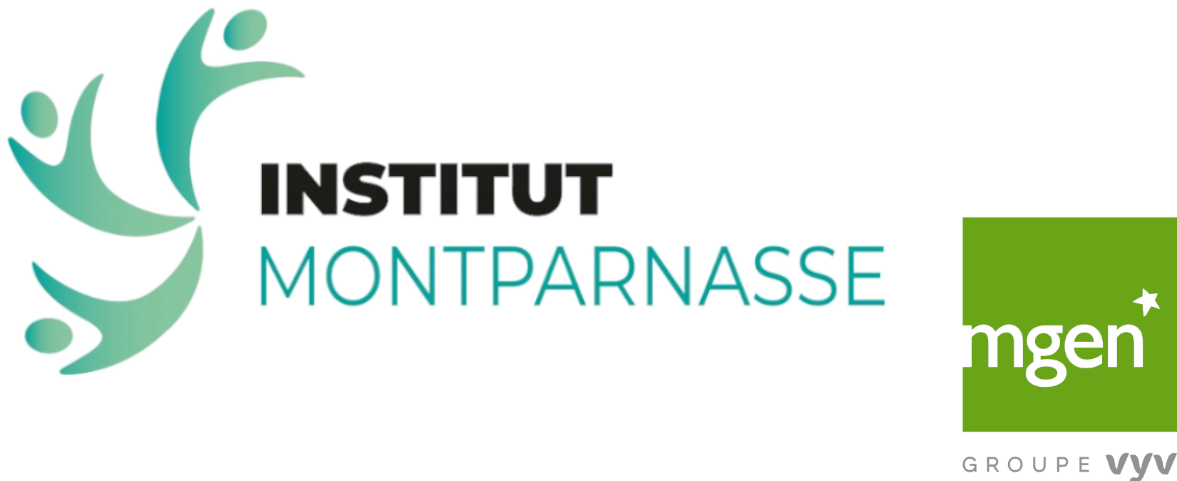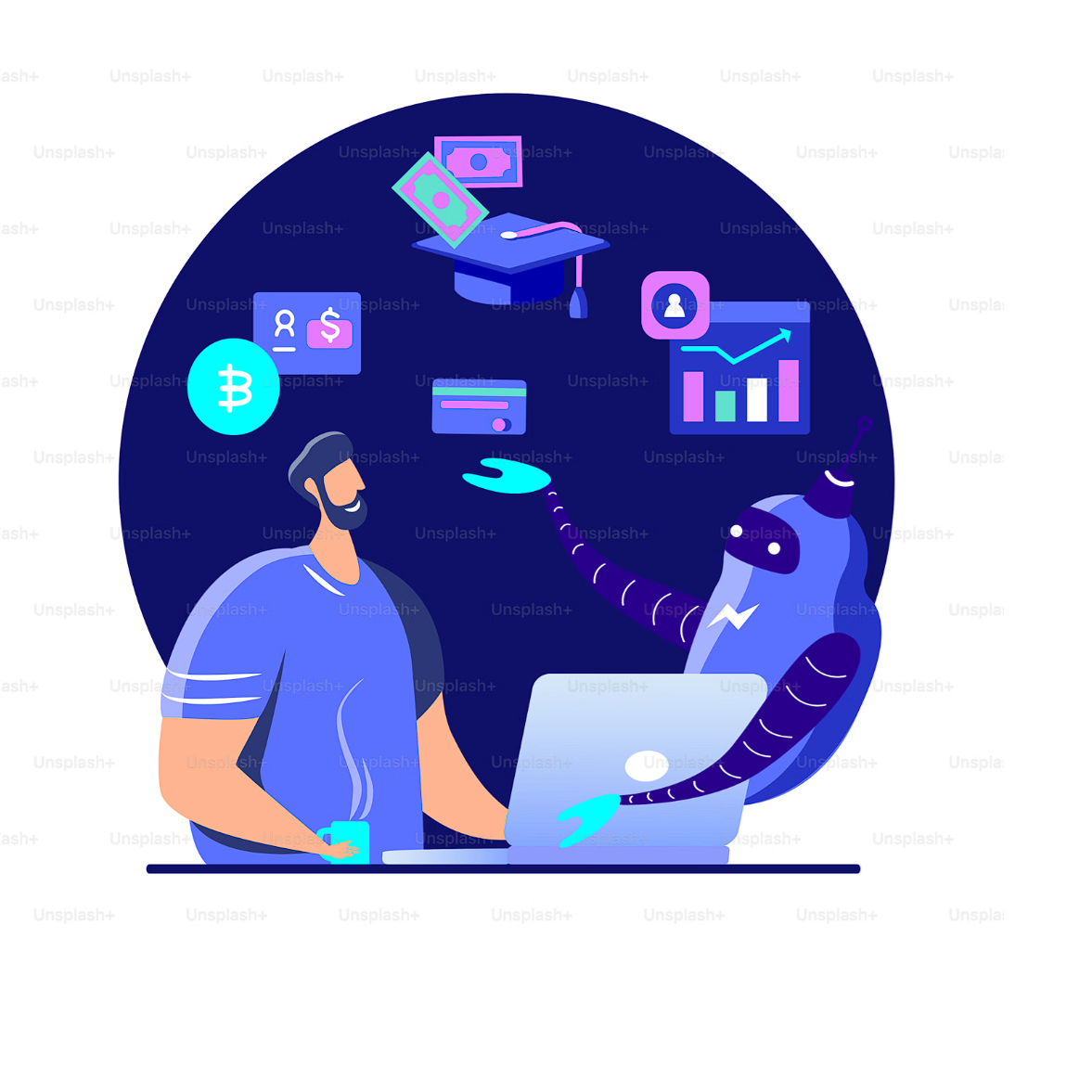References
| ↑1 | On peut aussi rappeler que l’une des traductions en Français de l’Anglais intelligence est renseignement. L’IA n’est pas intelligente, il s’agit d’un calcul de probabilités mathématiques d’occurrence. |
|---|---|
| ↑2 | Nous dédions ce travail à quatre mains à nos familles respectives, à nos amies et amis mutualistes, à celles et ceux qui ont cru en l’Institut Montparnasse, depuis sa création par Jean-Michel Laxalt, en 2009, et le font vivre, au conseil d’administration, au conseil scientifique, à la MGEN, au groupe VYV et chez nos multiples partenaires. Nous remercions chaleureusement Florian Betton de sa contribution. |
| ↑3 | Nous sélectionnons en gras ce que nous retenons tout particulièrement. |
| ↑4 | Nicolas Martin, La naissance du savoir. Dans la tête des grands scientifiques, Laurence Devillers, Informatique et intelligence artificielle, Les Arènes, 2023, p. 315. |
| ↑5 | https://denisevellachemla.eu/transc-dartmouth.pdf |
| ↑6 | Nous exprimons notre gratitude à Michel Paillet, Dominique Genelot, Jean-Yves Rossignol et Stéphane Bernard pour leurs engagements au service des progrès de l’intelligence de la complexité. |
| ↑7 | Jean Bennet, La Mutualité français à travers sept siècles d’histoire, Coopérative d’information et d’édition mutualiste, 1975. |
| ↑8 | On pourrait s’interroger sur les « retours d’expérience » des évolutions plus ou moins contraintes des vingt dernières années. |
| ↑9 | En témoigne le considérable travail d’Olivier Ezratty, Les usages de l’intelligence artificielle, 2021. https://www.oezratty.net/wordpress/2021/usages-intelligence-artificielle-2021/ Son blog, Opinions Libres, existe depuis 2006. |
| ↑10 | Les données évoquées dans cet article proviennent de plusieurs sources, dont les portails en ligne Statista et Eurostat. Elles visent à donner une idée des dimensions présentes de l’IA. |
| ↑11 | Emma Strubell, Ananya Ganesh, Andrew McCallum, Energy and Policy Considerations for Deep Learning in NLP (natural language processing), 2019. https://aclanthology.org/P19-1355/ |
| ↑12 | Dominique Cardon, A quoi rêvent les algorithmes. Nos vies à l’heure des big data, Seuil et La République des idées, 2015. |
| ↑13 | Aurélie Jean, Les algorithmes font-ils la loi ? Editions de l’Observatoire/Humensis, 2021. |
| ↑14 | Etienne Ghys, La théorie du chaos, CNRS Editions/De Vive Voix, 2023. |
| ↑15 | Gérard Berry, La pensée informatique, CNRS Editions/De Vive Voix, 2019. |
| ↑16 | Jean-Louis Le Moigne, Edgar Morin, Colloque de Cerisy, Intelligence de la complexité, Epistémologie et pragmatique, Editions de l’Aube, 2007. |
| ↑17 | Stéphane Bernard, Complexité mon amour ! 006 Ed. CCEE, 2022. |
| ↑18 | Pour une acculturation technique au NLP (natural language processing) : https://huggingface.co/learn/nlp-course/en/chapter1/2?fw=pt |
| ↑19 | Kai-Fu Lee, I.A. La plus grande mutation de l’Histoire, Les Arènes, 2019. |
| ↑20 | Karim Massimov, Le prochain maître du monde : l’intelligence artificielle, Fayard, 2020. |
| ↑21 | Stanislas Dehaene, Yann Le Cun, Jacques Girardon, La plus belle histoire de l’intelligence, Editions Robert Laffont, 2018. |
| ↑22 | Nous souhaitons souligner l’immense travail qui a permis l’écriture et la publication du Dictionnaire des mythes littéraires, sous la direction de Pierre Brunel, Editions du Rocher, 1988. |
| ↑23 | Christian Morel, Les décisions absurdes. Sociologie des erreurs radicales et persistantes. II Comment les éviter. III L’enfer des règles. Les pièges relationnels. Editions Gallimard, 2002, 2012, 2018. |
| ↑24 | François Belley, https://www.institutdiderot.fr/les-publications-de-linstitut-diderot/lhomme-politique-face-aux-diktats-de-la-com/ 2023. Le nouveau spectacle politique, Editions Nicaise, 2022. |
| ↑25 | Stephen Hawking, Brèves réponses aux grandes questions, Odile Jacob, 2018. |
| ↑26 | Jean Staune, L’intelligence collective, clé du monde de demain, Editions de l’Observatoire/Humensis, 2019. |
| ↑27 | Patrick Lagadec, Le continent des imprévus. Journal de bord des temps chaotiques, Les Belles Lettres, 2015. |
| ↑28 | Dominique Bidou, Le développement durable, l’intelligence du XXIe siècle, Editions PC, 2011. |
| ↑29 | Eloi Laurent, Economie pour le XXIe siècle. Manuel des transitions justes, Editions La Découverte, 2023. |
| ↑30 | Aurélien Barrau, Le plus grand défi de l’histoire de l’humanité. Face à la catastrophe écologique et sociale, Editions Michel Lafon, 2019. |
| ↑31 | Yuval Noah Harari, 21 leçons pour le XXIe siècle, Albin Michel, 2018. |
| ↑32 | Rutger Bregman, Humanité. Une histoire optimiste, Seuil 2020. |
| ↑33 | https://artificialintelligenceact.eu/fr/ |
| ↑34 | https://www.oecd.org/fr/publications/perspectives-de-l-emploi-de-l-ocde-2023_aae5dba0-fr.html |
| ↑35 | https://www.ilo.org/fr/resource/article/minimiser-les-effets-negatifs-du-chomage-technologique-induit-par-lia |
| ↑36 | https://www.lecese.fr/travaux-publies/impacts-de-lintelligence-artificielle-risques-et-opportunites-pour-lenvironnement |
| ↑37 | https://www.cnil.fr/fr/comment-permettre-lhomme-de-garder-la-main-rapport-sur-les-enjeux-ethiques-des-algorithmes-et-de |
| ↑38 | Mario Draghi, The future of European competitiveness, 2024, uniquement disponible en anglais. |
| ↑39 | André Yché, La puissance des Nations (préface de Jean Tulard), Economica, 2013. La cité des hommes, Economica, 2017. |
| ↑40 | Etienne Klein, Le goût du vrai, TRACTS, Gallimard, 2020. |
| ↑41 | Guénaëlle Gault, David Medioni, Quand l’info épuise. Le syndrome de fatigue informationnelle, Editions de l’Aube et Fondation Jean-Jaurès, 2023. |
| ↑42 | Eric Sadin, L’intelligence artificielle ou l’enjeu du siècle. Anatomie d’un antihumanisme radical, L’Echappée, 2018. |
| ↑43 | Yuval Noah Harari, op. cit., p. 14. |
| ↑44 | Bénédicte Manier, Un million de révolutions tranquilles, Les Liens qui Libèrent, 2016. |
| ↑45 | Sous l’animation et la coordination d’Alain Arnaud et du Dr. Nicolas Leblanc, Avec l’Economie Sociale et Solidaire … Agir ensemble pour la « bonne santé » de toutes et tous ! Editions du CIRIEC-France, rapport d’étude, 2024. https://www.ess-france.org/avec-l-ess-agir-pour-la-bonne-sante-de-toutes-et-tous |